Voici les règles basiques de la versification classique. Ces règles vous aideront à écrire votre propre poème sur la base de la poésie classique, à l’inverse des poèmes en vers libres.
Le “e” muet
Tout d’abord, il est important de rappeler qu’en poésie, le e muet est une catégorie phonétique : il peut être prononcé ou non selon la place qu’il occupe dans le vers.
Mais il reste un “e muet” par nature, qu’il soit prononcé ou non. Ce n’est donc pas parce qu’un e est muet, qu’il n’est pas prononcé.
Ce rappel est important afin de ne pas partir sur une mauvaise base de compréhension, et d’avoir tout faux par la suite.
En poésie classique, le “e” muet peut se prononcer ou ne pas se prononcer, selon les cas de figure.
Cas où le “e” muet ne se prononce pas
Le “e” muet ne se prononce pas dans les deux cas suivants :
- En fin de vers, le e muet simple (ex. ‘aimable’) et les ‘-ent’ verbaux tombent (on appelle cela une apocope) et ne se prononcent pas. Néanmoins, le -es final des mots au pluriel peut, lui, se prononcer pour respecter la métrique du vers. Exemple : “sauterelles”.
- Lorsqu’il est suivi par une voyelle, ou d’un “h” muet. Cela entraîne une élision. Exemple : « cette espérance » se prononce « cett’esperance » (le “e” est élidé).
En poésie, le « e muet », qui peut se décliner en “es” et “ent”, se prononce dans certains cas. C’est le cas lorsque :
- Le “e” est suivi par une consonne.
- Quand il est graphié “es” ou “ent”
Exemples :
« Femmes, moine, vieillards, tout était descendu. » (La Fontaine) >> Se prononcent car précédés d’une consonne.
« La rim[e] est une esclav[e] et ne doit qu’obéir. » (Boileau) >> Ne se prononcent pas car suivis d’une voyelle.
« L’ami du genr[e] humain n’est pas du tout mon fait. » (Molière) >> Ne se prononce pas car suivi d’un h muet.
« Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. » (Baudelaire) >> Se prononcent car orthographiés es et ent.
« Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissé[e]. » (Racine) >> Le 1er se prononce car “es”, le second non car fin de vers.
Evidemment, le “e” à l’intérieur d’un mot est parfois muet lorsqu’il est entre une voyelle et une consonne. Exemple : “je ne t’envierai pas”.
Enfin, les formes verbales en “aient” de l’indicatif imparfait et du conditionnel présent, ainsi que les formes soient et aient, sont élidées (effacées) même si le “e” est orthographié “ent”.
Exemple :
« Ils ne mourai[ent] pas tous, mais tous étai[ent] frappés. » (La Fontaine)
« Je consens que mes yeux soi[ent] toujours abusés. » (Racine)
Diérèse et synérèse
La diérèse, c’est le fait de rajouter artificiellement une syllabe dans un mot via deux voyelles. Exemple pour “passions” : pas / si / on.
La synérèse, c’est l’inverse. “Hier”, devient alors une syllabe au lieu de deux.
Autre exemple avec “lion” :
- Diérèse : « li-on » (deux syllabes) ;
- Synérèse : « lion » (une syllabe).
Dans la poésie classique, le choix entre diérèse et synérèse repose souvent sur l’étymologie latine ou grecque (ex. : « lion » en diérèse, « li-on », car issu de « leo »). Les traités de prosodie fournissent des listes de mots à prononcer en diérèse ou synérèse. Les poètes modernes peuvent toutefois choisir librement pour respecter le mètre, bien que cela s’écarte des règles strictes.
Bannir les hiatus
Un hiatus est la rencontre de deux voyelles prononcées consécutivement, sans consonne intermédiaire, entre deux mots (ex. : « tu es ») ou dans un même mot (ex. : « oasis »).
En poésie classique, les hiatus entre mots sont généralement évités, sauf si le premier mot se termine par un “e” muet (élidé). Les hiatus internes à un mot, comme « oasis », sont tolérés.
- “J’ai été ; qui a ; tu es : est à éviter
- Dans un même mot, comme “oasis”, c’est toléré.
Types de vers et nombre syllabes
Si le vers le plus connu est l’alexandrin (12 syllabes), il existe pléthore de types de vers en poésie classique :
- Tétrasyllabe : 4 syllabes ;
- pentasyllabe : 5 syllabes ;
- hexasyllabe : 6 syllabes ;
- heptasyllabe : 7 syllabes ;
- octosyllabe : 8 syllabes ;
- ennéasyllabe : 9 syllabes ;
- décasyllabe : 10 syllabes ;
- hendécasyllabe : 11 syllabes ;
- alexandrin : 12 syllabes.
L4alexandrin (12 syllabes) est le vers roi de la poésie classique française, souvent associé à la tragédie et à l’épopée.
Dans un alexandrin de 12 syllabes, la moitié du vers de six syllabes est une hémistiche. D’ailleurs, ces vers sont coupés en leur moitié en versification classique, par une césure.
Dans l’alexandrin classique, la césure divise donc le vers en deux hémistiches de 6 syllabes. Dans l’alexandrin romantique (trimètre), le vers peut être divisé en trois mesures (ex. : 4/4/4), comme dans « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir » (Corneille).
Par ailleurs, le sens peut se suivre d’un vers à l’autre : on appelle cela l’enjambement. L’enjambement est rare en poésie classique stricte, mais plus courant à l’époque romantique.
Coupes et césures
Définition de la coupe en poésie
Une coupe en poésie est un temps d’arrêt dans un vers, une pause rythmique ou syntaxique marquée par la voix. Il peut y avoir plusieurs coupes dans un vers.
Définition de la césure en poésie
La césure, quant à elle, est la pause métrique principale, obligatoire dans l’alexandrin (au 6è pied) et le décasyllabe (au 4e ou 5e pied), divisant le vers en deux hémistiches.
Dans l’alexandrin traditionnel, la césure (donc la coupe principale !) se situe au milieu du vers, qu’elle divise en deux « hémistiches » d’égale longueur.
« Rien n’est beau que le vrai, le vrai seul est aimabl[e]. » [Boileau]).
« À vaincre sans péril, on triomphe sans gloir[e]. » (Corneille)
Les formes classiques n’imposent pas toutes des césures, mais c’est le cas pour l’alexandrin (12 pieds), le décasyllabe (10 pieds) et éventuellement l’octosyllabe (8 pieds). Sauf exceptions ou idées novatrices, la césure se trouve à l’hémistiche (le milieu du vers).
Toutefois, dans certaines formes romantiques, on peut trouver deux césures. On appelle cela un trimètre, c’est-à-dire un vers à trois mesures égales :
« Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. » (Corneille)
Il existe également des alexandrins présentant quatre mesures égales :
« J’ai langui, j’ai séché, dans les feux, dans les larm[es]. » (Racine)
Hémistiche et élision du “e” muet
Dans un alexandrin, il doit y avoir obligatoirement coupure du rythme entre les deux hémistiches, au niveau de la césure, c’est-à-dire au milieu du vers.
Et la difficulté, c’est qu’au niveau de cette coupure, la règle de l’élision du “e” muet que l’on avait vu au début de cet article ne peut pas s’appliquer.
Rappel sur l’élision :
L’élision se produit quand un mot se terminant par un e muet est suivi d’un mot commençant par une voyelle ou un “h” muet. Le e disparaît alors dans la prononciation (et donc ne compte pas dans la métrique).
Exemple : “Que l’on me donne un autre cœur” → le e de donne s’élide devant un.
Césure et élision
Mais à la césure, la situation change.
Si un mot se termine par un e muet juste avant la césure, ce e :
- ne peut pas être élidé, car la pause coupe le souffle entre les deux hémistiches ;
- ne peut pas non plus être prononcé, car cela ajouterait une syllabe ;
- on dit donc que le e tombe.
Conséquence : le mot suivant ne doit pas commencer par une voyelle ni par un “h” muet, pour éviter un hiatus.
Exemples :
« Ma vie est une âme // ouverte aux souvenirs »
Ici :
- “âme” se termine par un e muet ;
- “ouverte” commence par une voyelle ;
- donc le “e” muet ne se prononce pas ici ;
- le “e” de “âme” tombe car comme nous l’avons vu, la règle nous dit que si un mot se termine par un e muet juste avant la césure, on dit qu’il tombe, et il ne se prononce pas.
- Par ailleurs, sur le plan de la poésie classique française, “âme” est suivi de “ouverte”, donc d’une voyelle, ce qui crée un hiatus.
Résultat : ce vers est faux en métrique classique, et en plus, le “e” muet ne se prononce pas, il manque donc une syllabe.
Pour corriger, le poète doit remplacer “âme” par un mot se terminant par une syllabe pleine (sans “e” muet).
Exemples de correction :
« Ma vie est un regard // fermé sur mes souvenirs » ✅ (car “regard” se termine par une consonne forte, syllabe pleine)
« Ma vie est un esprit // fermé aux souvenirs » ✅ (car “esprit” se termine par une syllabe pleine)
À noter qu’à la césure, même si un “e” muet est suivi d’une consonne (comme “âme // fermée”), il tombe quand même à cause de la pause rythmique obligatoire. C’est pourquoi les règles classiques interdisent tout “e” muet en sixième position.
Une autre correction possible aurait été la suivante : « Mon cœur est un écho // ouvert sur d’autres rives » ✅ (pas de “e” muet à la fin du premier hémistiche).
Ce vers aurait toutefois posé un autre problème en poésie classique stricte à cause du hiatus (écho // ouvert), bien que cette règle se soit considérablement assouplie à partir du romantisme : Hugo, Musset et la plupart des poètes modernes acceptent sans problème l’hiatus à la césure, et la poésie contemporaine n’y prête plus guère attention.
Les rimes
Une rime se caractérise par sa sonorité ou encore son genre (féminine ou masculine), sa qualité et sa disposition.
Genre des rimes
Dans la poésie classique, il convient d’alterner les rimes féminines et masculines, selon le schéma FFMM (ou MMFF).
- Une rime féminine se termine par un « e muet » (graphié « e », « es » ou « ent ») qui, donc, ne se prononce pas. Dans tous les autres cas, la rime est dite masculine.
- Une rime masculine rime avec une rime masculine, une féminine avec une féminine. Ainsi, « florale » et « floréal » ne riment pas. A l’inverse, « amour » (masculin) rime avec « jour » (masculin) ; « amie » (féminin) rime avec « vie » (féminin).
Exemple :
« Que tu brilles enfin, terme pur de ma cours[e]. » (Valéry) >> rime féminine.
« On a souvent besoin d’un plus petit que soi. » (La Fontaine) >> rime masculine.
Qualité des rimes
En poésie classique, on évite autant que possible la rime pauvre.
- Rime pauvre : seule la dernière voyelle tonique rime (aussi / lit) ;
- rime suffisante : deux sons en commun. La dernière voyelle tonique et une même consonne, avant ou après la voyelle (cheval / banal ou pela / fêla) ;
- rime riche : trois sons en commun : banal / chenal ;
- rime très riche : plus de trois sons en commun.
Disposition des rimes
Il y a différentes façons de disposer les rimes. Les principales sont les suivantes :
- AAAA : rimes continues ;
- AABB : rimes plates ;
- ABAB : rimes croisées ;
- ABBA : rimes embrassées ;
En poésie classique, on peut utiliser ces quatre formes. Les rimes plates sont principalement utilisées dans les genres théâtraux – comédie sérieuse, tragi-comédie, tragédie –, dans les épopées ou les poèmes didactiques, dans les épîtres.
On peut également tenter ceci :
- ABCABC : rimes alternées ;
- AABCCBDDB : rimes tripartites ;
- AAABCCCBDDDB : rimes quadripartites.
Dans tous les cas, il convient d’alterner rimes féminines et masculines, quelque soit la disposition choisie.
Rimes au singulier et au pluriel
On parle de rime au pluriel quand un vers se termine par « s », « x » ou « z ». Ainsi, un vers qui finit par « tu peux » est considéré comme pluriel.
Dans tous les autres cas, il s’agit de rimes au singulier. Une rime au pluriel doit rimer avec une rime au pluriel, au singulier avec une rime au singulier.
Exemples de rimes qui respectent à la fois la dichotomie singulier / pluriel, et féminin / masculin :
- “Lettres” et “kilomètres” ;
- “outrage” et “courage” ;
- “exploits” et “lois” ;
Strophes
Une strophe est caractérisée par son nombre de vers (donc de lignes) :
- Le monostique : un seul vers ;
- le distique (ou couplet ou deuzain) : deux vers ;
- le tercet : trois vers ;
- le quatrain : quatre vers ;
- le quintil : cinq vers ;
- le sizain : six vers ;
- et ainsi de suite, jusqu’à 17 vers (le « dix-septain »).
Le poème est constitué de strophes et impose un cadre stylistique préétabli, plus ou moins complexe suivant le nombre de strophes, l’alternance de rimes et le nombre de mètres à chaque vers. En voici les formes classiques les plus courantes :
- Ballade : Trois strophes de 8 ou 10 vers, suivies d’un envoi (demi-strophe de 4 ou 5 vers). Chaque strophe se termine par un refrain.
- Rondeau : 13 ou 15 vers courts, sur deux rimes, avec un refrain repris partiellement.
- Sonnet : Deux quatrains et deux tercets. Schémas classiques : ABBA ABBA CCD EED/EDE (sonnet français) ou ABBA ABBA CDE CDE (sonnet italien).
- Ode : deux strophes égales plus une plus courte ;
Conseils divers
- Ne pas abuser des verbes banals : être, aller, faire…
- Eviter les répétitions de mots.
- Ne pas abuser des chevilles : trop, très, oh, etc…
- Eviter les échos, à savoir les sons identiques ou voisins qui sont trop rapprochés. Espacez-les d’au moins 4 vers.
Et voilà, vous êtes parés pour écrire votre poème ! Si d’autres règles vous viennent à l’esprit, ou que vous souhaitez apporter quelques précisions, n’hésitez pas à rebondir dans les commentaires 🙂
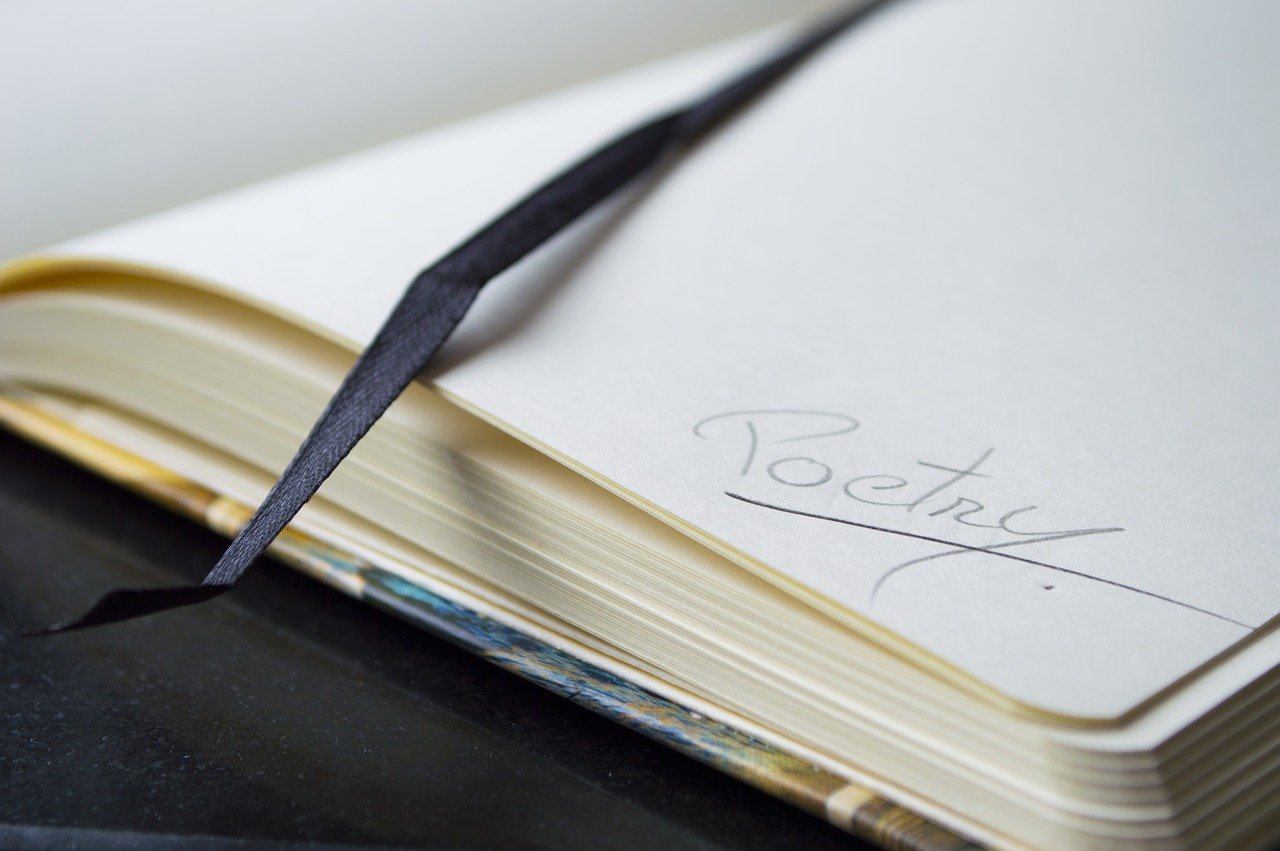
2 replies on “Les règles des vers dans la poésie classique”
Comment pouvez-vous écrire une chose pareille ???
Ma vie est une âme // fermée aux souvenirs
n’est pas un alexandrin DU TOUT, ni selon les règles classiques ni selon aucune règle plus tardive. La sixième syllabe (celle qui précède la césure) ne peut pas contenir un e muet ! Elle doit être accentuée et pleine.
Bonjour Laurent,
Merci beaucoup d’avoir signalé cette erreur !! J’ai encore beaucoup à apprendre en poésie classique et il semblerait que j’ai été induit en erreur sur ce passage. J’ai procédé à une correction, pourriez-vous me dire si tout est correct cette fois-ci ?
Merci et encore désolé pour cette erreur 🙂